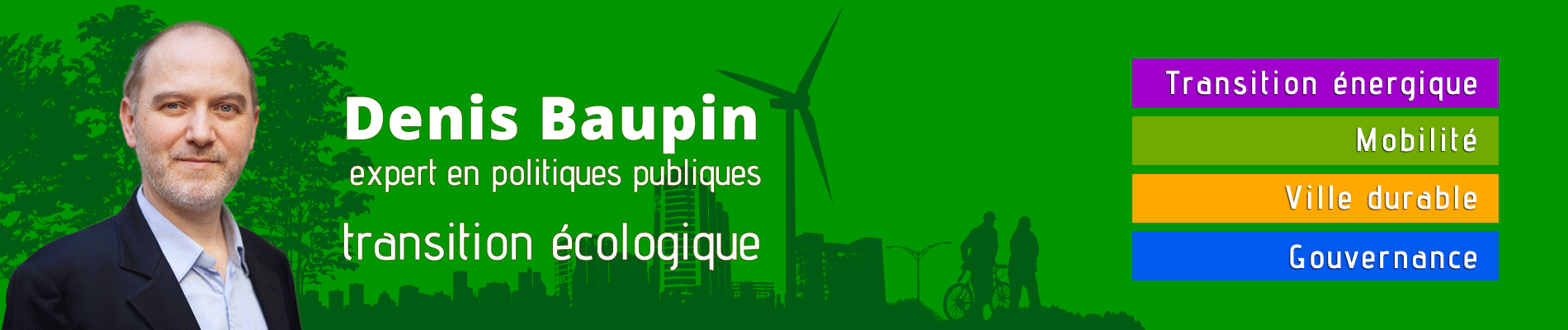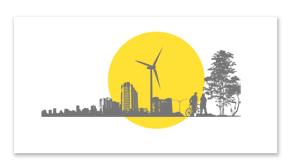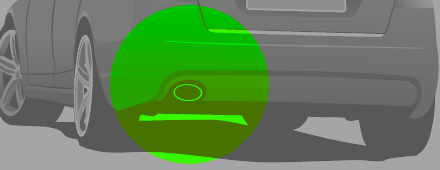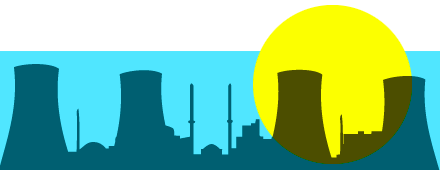Nous vivons le naufrage du vieux monde…
Nous ne sommes pas seulement «en crise».
Nous vivons le naufrage du vieux monde…
mais peut-être aussi la naissance du nouveau

Le mot fait aujourd’hui consensus : nous serions entrés en « crise ». Crise économique : tout le monde en convient. Crise sociale : c’est de plus en plus évident, même si déjà là, le consensus s’effrite. Crise écologique : nous le disons, d’autres reprennent le mot, mais si peu comprennent que ces « crises » ne font qu’une, celle du libéral productivisme, un modèle absurde dont les ressorts même ne pouvaient que conduire à « la crise ».
Sortir de l’ambiguïté
Comme tout mot-valise, le terme dissimule de nombreux désaccords, camouflés derrière ses ambiguïtés.
Première ambiguïté : sommes-nous face à une « crise » structurelle ? Ou n’est-elle qu’un simple épisode atypique, dans un long fleuve censé redevenir tranquille une fois celle-ci passée ? A entendre les « grands analystes économiques qui font autorité » – qui n’avaient pas vu la crise venir, mais continuent d’asséner leurs vérités toujours péremptoires – « 2009 sera difficile ; 2010 sonnera la reprise ». Il suffirait donc d’attendre patiemment, que « la crise passe », que quelques correctifs soient mis en place pour « éviter les abus » (contrôler les traders, empêcher la titrisation, etc.), et hop repartir de l’avant comme si de rien n’était… Sarkozy ne dit d’ailleurs pas autre chose quand il définit son rôle comme celui qui doit retarder l’entrée dans la crise, et accélérer la sortie.
Deuxième ambiguïté : la « crise » a-t-elle des causes intrinsèques, identifiables auxquelles il faudrait s’attaquer ? Ou n’est-ce finalement qu’un phénomène imprévisible, la conséquence d’un battement d’ailes de papillon de l’autre côté de l’Atlantique, qui se serait propagé de façon incontrôlable ?  A entendre Laurence Parisot pester contre les manifestants qui, le 29 janvier « en pleine tempête, manifestent contre la tempête », on finirait par croire que cette « crise » ne serait qu’un phénomène météorologique, qu’une catastrophe naturelle, un désastre face auquel nous serions tous victimes, tous égaux, tous responsables… et donc finalement personne.
A entendre Laurence Parisot pester contre les manifestants qui, le 29 janvier « en pleine tempête, manifestent contre la tempête », on finirait par croire que cette « crise » ne serait qu’un phénomène météorologique, qu’une catastrophe naturelle, un désastre face auquel nous serions tous victimes, tous égaux, tous responsables… et donc finalement personne.
On voit aisément à quelles erreurs, tant sur le diagnostic et surtout sur les remèdes, peuvent conduire ces ambiguïtés.
Crise ou naufrage ?
On voit à quel imaginaire totalement différent elles renvoient, si, au terme de « crise », on privilégiait celui de « naufrage » bien plus explicite : naufrage d’un système économique, naufrage même des concepts sur lequel il est basé, naufrage dans le rapport de l’humanité elle-même avec son écosystème qu’il épuise et détruit sans vergogne, sapant par là même nos conditions de survie.
Plus question alors, de croire à une hypothétique « sortie de crise » qu’il suffirait d’attendre : il y a une obligation alors de s’interroger sur les raisons du naufrage et sur ce qui y a conduit. Et pour savoir si les capitaines du navire sont bien les mieux placés pour donner des leçons sur la façon d’en sortir…tout particulièrement quand ils refusent ne serait-ce que d’assumer leur part de responsabilité. Au contraire, ils  continuent de se voir attribuer boucliers fiscaux, bonus et stocks options, par ceux qui, à coup de plans de relance datés – s’apparentant plus à de l’acharnement thérapeutique pour nucléocrates, constructeurs automobiles et aéronautiques – tentent de masquer leur manque d’imagination.
continuent de se voir attribuer boucliers fiscaux, bonus et stocks options, par ceux qui, à coup de plans de relance datés – s’apparentant plus à de l’acharnement thérapeutique pour nucléocrates, constructeurs automobiles et aéronautiques – tentent de masquer leur manque d’imagination.
Car naufrage d’un système global il y a bien. Les subprimes, la titrisation et les traders qui jouent l’économie au casino ne sont pas que les nouveaux frankensteins des apprentis sorciers de la finance. Ils sont les conséquences logiques d’un système qui ne conçoit sa survie que dans une éternelle fuite en avant. Un système absurde où qui stagne s’effondre, et oblige donc, quand les limites physiques et rationnelles sont atteintes, à inventer des bulles artificielles, irrationnelles, insoutenables, simulant une croissance infinie… jusqu’au moment où elles explosent non seulement à la tête de leurs créateurs, mais de tous les décideurs qui se dissimulent depuis des décennies dans la posture de l’autruche, refusant, malgré les alertes, de regarder la réalité en face.
Sortir du toujours plus
En 2009, nous dit-on, nous devrons affronter une « récession ». Catastrophe nationale et internationale, certes. Mais regardons-y de plus près : à supposer que cette récession soit grosso modo du même niveau que la croissance de 2008, notre pays aura donc en 2009 le même PNB qu’en 2007. Nous aurons donc produit autant de « richesses » à deux ans d’écart, pour une population grosso modo équivalente. Indéniablement doit être considéré comme absurde, et donc destiné à un inexorable naufrage, un système qui, alors qu’il produit à deux ans d’écart les mêmes richesses pour la même population, est considéré sain la première fois, et en situation de catastrophe généralisée la seconde.
La façon dont cette richesse est répartie constitue une question clé. Entre 2007 et 2009, les injustices se sont accrues : à richesse équivalente, certains se gavent plus que jamais, et d’autres sont d’autant plus injustement obligés de se serrer la ceinture qu’ils sont directement victimes de l’égoïsme et de l’aveuglement des premiers.
Réduire les inégalités, mieux répartir les richesses produites est donc un impératif. C’est ce qui s’est exprimé massivement dans la rue le 29 janvier dernier.
 Mais cela ne saurait suffire. Et c’est en cela que le discours de gauche classique, misant tout sur une supposée relance de la consommation, pêche par un manque total d’analyse et d’imagination. Tout d’abord parce que mieux répartir les richesses entre riches et pauvres du Nord de la planète ne répond en rien à l’une des conséquences majeures de la mondialisation : l’aspiration à plus de justice, à une meilleure répartition des richesses entre Nord et Sud et la demande massive des populations du Sud de ne plus être la variable d’ajustement de ces accords « entre riches ».
Mais cela ne saurait suffire. Et c’est en cela que le discours de gauche classique, misant tout sur une supposée relance de la consommation, pêche par un manque total d’analyse et d’imagination. Tout d’abord parce que mieux répartir les richesses entre riches et pauvres du Nord de la planète ne répond en rien à l’une des conséquences majeures de la mondialisation : l’aspiration à plus de justice, à une meilleure répartition des richesses entre Nord et Sud et la demande massive des populations du Sud de ne plus être la variable d’ajustement de ces accords « entre riches ».
Mais elle ne saurait surtout suffire parce que la course au « toujours plus » (plus de croissance, travailler plus, gagner plus, consommer plus, gaspiller plus) a dorénavant atteint ses limites physiques, incontournables.
Il faut assumer qu’il y a naufrage du système, et non simple crise passagère. Et donc accepter que les remèdes classiques, conjoncturels, ne sont plus de mises. Ils sont non seulement insuffisants, mais probablement même accélérateurs du naufrage. Qu’on en juge…
Aider le secteur automobile ? Oui bien sûr, car il n’est pas question de sacrifier les dizaines de milliers de salariés victimes de l’incompétence de leurs dirigeants. Mais injecter des milliards sans les investir dans une reconversion écologique du secteur (véhicules plus légers, moins puissants et moins polluants, transports collectifs, etc.) – ce que même Arnold Schwarzenegger et Barack Obama ont compris -, c’est non seulement gaspiller l’argent public, mais surtout se condamner à une crise bien plus dure encore quand l’industrie automobile française sera la seule à ne pas avoir pris le virage écologique.
Investir dans le bâtiment ? Oui évidemment. Mais pas sans conditions, pas pour construire des stades ou des tours sans utilité sociale et porteurs de gabegie énergétique. L’adaptation énergétique des bâtiments (logements, bureaux, écoles, etc.) constitue un gisement bien plus prometteur et triplement vertueux : énergétiquement, socialement (en protégeant les locataires contre les hausses à venir du prix de l’énergie) et économiquement (en créant des dizaines de milliers d’emplois non délocalisables).
Développer les énergies nouvelles ? Encore oui. Mais en abandonnant l’arrogance nucléocrate typiquement française, économiquement absurde, écologiquement terriblement risquée, et surtout totalement inadaptée aux besoins de demain, décentralisés, au plus proche des consommations, évitant ainsi ces centaines de milliers de pylônes qui s’écroulent à chaque tempête.  Dans le pays qui prétend exporter de l’électricité au monde (comme aime à la rappeler Nicolas Sarkozy), des dizaines de milliers de ménages attendent toujours d’être de nouveau raccordés au réseau quelques semaines après le coup de vent ! Quand la planète entière comprend qu’en captant les énergies naturelles locales renouvelables, on arrivera peut-être à limiter la gravité du choc énergétique et climatique, la France reste condamnée à la pensée unique nucléaire.
Dans le pays qui prétend exporter de l’électricité au monde (comme aime à la rappeler Nicolas Sarkozy), des dizaines de milliers de ménages attendent toujours d’être de nouveau raccordés au réseau quelques semaines après le coup de vent ! Quand la planète entière comprend qu’en captant les énergies naturelles locales renouvelables, on arrivera peut-être à limiter la gravité du choc énergétique et climatique, la France reste condamnée à la pensée unique nucléaire.
Un autre monde…
A l’aube de 2009, l’humanité est probablement devant l’un de ses plus difficiles défis : inventer une organisation, à des échelles spatiale et temporelle inconnues jusque-là, qui non seulement devra garantir des droits équivalents à tous ses membres – et ce non seulement au niveau d’un territoire, mais de l’ensemble de la planète – mais devra en plus le faire en préservant son écosystème et donc les droits des générations futures, ses membres en devenir. Les civilisations anciennes surent le prendre en compte, contrairement au système dans lequel nous vivons.
Cet autre monde, plus proche de Belem que de Davos est possible. Il est indispensable. Il y a urgence.